Se forger ses propres convictions : l’art d’être son propre conseiller
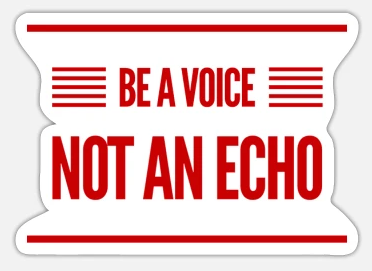
Sommaire :
Introduction : L’importance de développer sa propre pensée 1/ Comprendre l’influence du regard extérieur 2/ Se reconnecter à sa capacité d’analyse personnelle 3/ Oser expérimenter et tirer ses conclusions 4/ Équilibrer respect d’autrui et affirmation de soi Conclusion : Vers une autonomie guidée par l’expérience
Introduction : L’importance de développer sa propre pensée
Lorsque nous cherchons des réponses à nos doutes, il est fréquent de se tourner vers l’extérieur pour recueillir des conseils : des amis, des livres spécialisés ou des experts dans divers domaines. Cette démarche est tout à fait légitime, car l’expérience des autres peut nous inspirer et nous faire gagner un temps précieux. Toutefois, la véritable transformation ne survient que si nous prenons la responsabilité d’adapter ces avis à notre situation particulière.
Le parcours d’une personne qui souhaite adopter une démarche de réflexion autonome commence souvent par un constat : celui de se sentir parfois submergé par la quantité d’informations disponibles. Nos sociétés offrent un nombre impressionnant de programmes télévisés, de sites internet et de formations dispensées par des « spécialistes ». Bien que leur apport puisse être bénéfique, nous pouvons aussi vite perdre le fil de nos propres valeurs, car nous accordons la priorité à des opinions extérieures.
À force de consulter des sources multiples, nous risquons de nous sentir dépendants de la confirmation d’une autorité ou d’un « connaisseur » avant de prendre la moindre décision. Or, nous avons la capacité d’apprendre de nos vécus, d’écouter nos ressentis intimes et de faire fonctionner notre esprit critique. Se fier uniquement à la parole d’un autre, même d’un mentor reconnu, peut nous détourner d’un apprentissage pourtant fondamental : celui que nous apporte la confrontation directe avec la réalité, c’est-à-dire nos propres expériences.
Être son propre conseiller implique donc de développer un sens aigu de la remise en question de soi, tout autant que de l’ouverture à l’opinion d’autrui. Il ne s’agit pas de rejeter la connaissance ou l’avis des autres, mais plutôt de l’examiner, de l’éprouver pour ensuite confirmer ou infirmer. C’est en adoptant cette posture que nous nous rendons compte de ce qui est pertinent pour nous et de la manière dont tel ou tel principe peut s’intégrer dans notre vie quotidienne.
Cette introduction pose les bases d’une réflexion sur la nécessité, voire l’urgence, de devenir plus actif dans notre propre cheminement. En nous responsabilisant vis-à-vis de nos choix, nous apprenons à interroger et à interpréter ce que nous disent nos proches ou les experts. L’idée est de ne plus être un récepteur passif, mais un acteur critique et conscient de ses décisions.
1/ Comprendre l’influence du regard extérieur
Dans nos sociétés, le regard des autres exerce une très grande influence. Dès notre enfance, l’éducation parentale et scolaire place souvent la validation extérieure au centre du processus d’apprentissage. Nous recevons des félicitations si nous faisons correctement nos devoirs, si nous ne nous écartons pas trop des normes établies. Les commentaires positifs ou négatifs deviennent de puissants repères. Bien sûr, recevoir un encouragement nous motive, tandis qu’une critique nous incite à nous améliorer ou à éviter de reproduire la même erreur.
Avec le temps, ce mécanisme nous fait associer l’idée de « savoir » à celle de « reconnaissance ». Nous prenons peu à peu l’habitude de rechercher l’aval d’une autorité — enseignant, patron, figure publique — pour valider qu’une démarche est légitime. Cette posture n’est pas mauvaise en soi : il est naturel de vouloir confirmer que l’on agit correctement. Cependant, elle devient problématique lorsqu’elle nous empêche d’explorer en profondeur nos propres capacités.
Parfois, le jugement extérieur finit par occuper une place démesurée : nous nous sentons contraints de coller à l’opinion générale, aux tendances ou au modèle commun. Or, tout un chacun possède une sensibilité unique et une histoire singulière. Ces deux éléments permettent de considérer les points de vue extérieurs et de les confronter à nos ressentis. En d’autres termes, avant de changer nos habitudes parce que quelqu’un l’a conseillé, n’oublions pas de nous demander si cela fait sens pour nous.
Il est aussi essentiel de souligner que l’influence extérieure ne se limite pas à l’entourage direct. Les médias, les réseaux sociaux, les figures publiques, tout cela pèse sur nos choix. Combien de fois entendons-nous : « tout le monde fait ceci ou cela, c’est la nouvelle tendance » ? Or, la popularité d’un conseil ne prouve pas nécessairement son bien-fondé pour notre situation particulière.
Dans cette optique, être son propre conseiller consiste à examiner chaque proposition, chaque idée, non pas pour la rejeter aveuglément, mais pour la passer au crible d’une analyse personnelle. Une remise en question systématique nous aide à débusquer nos automatismes, à savoir si nous agissons vraiment selon ce qui nous correspond ou si nous nous laissons porter par la vague de l’opinion majoritaire.
Pour autant, ce point de vue n’exige pas de s’opposer à tout avis d’autrui. C’est plutôt un équilibre à trouver : savoir accueillir des suggestions, tout en conservant un esprit critique. Par ce biais, nous gardons un ancrage dans ce que nous ressentons profondément juste ou adapté, sans toutefois négliger la possibilité d’apprendre des autres.
Lorsque nous prenons conscience de la force du regard extérieur, nous comprenons mieux pourquoi il est si important de réapprendre à écouter nos convictions. Nous arrivons à mesurer la distance qui sépare l’ensemble des conseils reçus et ce qui, au fond, fait vibrer notre motivation personnelle. S’approprier les connaissances transmises par d’autres n’implique pas que nous nous effacions. Au contraire, nous pouvons les intégrer à nos réflexions comme des briques posées sur la base solide de notre vécu.
2/ Se reconnecter à sa capacité d’analyse personnelle
Pour être son propre conseiller, la deuxième étape fondamentale consiste à renouer avec notre aptitude innée à observer, raisonner et conclure. Dans un monde saturé d’informations, le plus difficile n’est pas d’accéder à des contenus, mais plutôt de les trier et de les hiérarchiser. Face à la diversité des opinions disponibles, nous sommes parfois tentés de suivre les raccourcis mentaux, comme par exemple : « cet individu est qualifié, il doit forcément connaître la vérité ». Bien sûr, l’expertise des uns et des autres est précieuse. Néanmoins, il serait dommage de minimiser notre propre potentiel d’exploration.
Reprendre confiance en notre analyse, c’est tout d’abord nous rappeler que nous avons notre lot d’expériences. Même si notre parcours ne ressemble pas à celui d’un auteur reconnu ou d’un scientifique réputé, il a une valeur unique. Les expériences que nous avons menées, les difficultés surmontées et nos succès personnels sont autant d’indices sur la façon dont nous réagissons et sur ce qui fonctionne pour nous.
Pour nourrir notre capacité d’analyse, nous pouvons nous entraîner à : • Confronter nos lectures, nos conversations, à nos sensations et nos souvenirs. Par exemple, si un livre de développement personnel suggère de méditer chaque matin, pourquoi ne pas tester cette habitude pendant un certain temps ? Ensuite, tirer des conclusions objectives : me suis-je senti plus calme, plus concentré ? Ai-je noté un impact sur mes humeurs ? • Poser des questions : d’où vient cette information ? Qu’est-ce qui motive la personne qui me la donne ? Quelles valeurs sous-tendent cette affirmation ? Ces interrogations simples, parfois même instinctives, nous aident à aller au-delà du premier abord.
Cette capacité à mener notre propre enquête se solidifie quand nous prenons conscience que nul ne détient à lui seul l’absolue vérité. Même les plus grands maîtres reconnaissent qu’ils continuent d’apprendre. Quand on adopte ce regard, on devient plus apte à expérimenter sans crainte et surtout à tirer profit de nos essais, de nos erreurs, plutôt que de tout simplement suivre une méthode comme un modèle figé.
Il est vrai que cette démarche requiert plus d’implication qu’une simple application de consignes. Pour certains, il s’agit même d’un renversement complet : il ne s’agit plus de dépendre d’un professeur, mais de devenir son propre « testeur » dans le laboratoire de la vie. Cette liberté nouvelle peut inquiéter, car elle sous-entend l’absence d’un filet de sécurité absolu. Pourtant, c’est précisément dans cet espace que se développe notre autonomie.
Replacer la responsabilité au cœur de nos choix implique aussi d’accepter la possibilité d’échouer ou de réussir par nous-mêmes, de façon lucide et humble. L’important, c’est que chaque décision soit le fruit d’un processus de réflexion qui nous appartient. En procédant ainsi, nos certitudes ne s’appuient plus seulement sur les dires d’autrui, mais sur un ressenti solide, basé sur ce que nous avons effectivement constaté, ressenti et compris.
3/ Oser expérimenter et tirer ses conclusions
Il est aisé d’accumuler des conseils et de lire des guides pratiques. On peut également discuter avec de multiples personnes et recevoir des visions parfois contradictoires. Pourtant, l’élément décisif reste la mise en pratique. Lorsque nous envisageons une nouvelle habitude ou une nouvelle façon de penser, il ne s’agit pas de s’arrêter à la théorie : c’est l’application concrète qui nous montre si, oui ou non, cela nous convient vraiment.
Souvent, nous hésitons à prendre cette étape parce que l’erreur nous fait peur. Nous craignons de nous tromper de voie, de gaspiller du temps, ou encore de ne pas être à la hauteur. Pourtant, c’est précisément dans l’erreur et l’essai que se situe l’apprentissage le plus riche. Une astuce régulièrement donnée dans le monde de l’entrepreneuriat ou du développement personnel consiste à commencer par des petits pas. Tester une nouvelle approche, observer les résultats, ajuster, puis répéter.
Par exemple, si nous entendons qu’il est bénéfique de s’exprimer librement pour résoudre un conflit, nous pouvons nous entraîner dans un cadre plus sûr : discuter de sujets délicats avec un proche bienveillant ou un collègue qui sera réceptif. Nous analysons ensuite nos impressions, ce qui a fonctionné ou non, et nous déterminons ce qui peut être ajusté. Cette phase d’expérimentation concrète nous libère de la passivité : nous devenons acteurs de notre propre progression.
Par ailleurs, c’est en accumulant ces expériences que nous nous forgeons une vision du monde plus nuancée et plus personnelle. Un concept qui paraît très efficace sur le papier peut ne pas nous convenir pour des raisons de tempérament, de style de vie ou d’objectifs. Inversement, une idée que nous avions tendance à rejeter d’emblée peut se révéler pertinente, une fois adaptée à notre contexte.
Ainsi, oser tester dans la vraie vie nous aide à prendre conscience que ce qui est vrai pour l’un ne l’est pas forcément pour l’autre. Les individus ont des parcours de vie, des environnements et des priorités différentes. L’important est de trouver l’harmonie entre ce que nous préconise telle ou telle méthode et ce que nous éprouvons lorsqu’elle est mise en œuvre.
Ce processus d’expérimentation nous invite également à nous pardonner les éventuelles maladresses ou même les échecs. Ceux-ci ne sont pas un frein, mais bien un signal d’alarme ou un jalon qui montre qu’il faut peut-être réorienter nos efforts. Les personnes qui osent le plus se lancer, malgré l’incertitude, sont celles qui acquièrent le plus d’expérience et, à terme, de confiance en leurs jugements.
En fin de compte, être son propre conseiller n’implique pas de réussir du premier coup, mais de s’accorder la liberté d’essayer. Même lorsque nous écoutons un expert, ce dernier ne peut vivre à notre place. Les avis, aussi fondés soient-ils, ne remplaceront jamais notre ressenti direct. C’est cette accumulation de tentatives, d’erreurs et de succès, petite ou grande, qui nous confère une assise solide pour prendre nos décisions futures.
4/ Équilibrer respect d’autrui et affirmation de soi
Un écueil consisterait à penser que choisir de devenir son propre conseiller revienne à rejeter tout avis extérieur, à adopter une posture de défiance permanente. Au contraire, l’ouverture d’esprit est un atout essentiel pour élargir notre regard. Il est plus que probable que nous croisions au cours de notre vie des personnes éclairées, dont l’expérience peut être un véritable trésor.
Toutefois, respecter l’avis d’autrui ou bénéficier de son expérience ne doit pas nous conduire à nous effacer. Nous pouvons écouter et accueillir des points de vue, tout en maintenant la responsabilité d’y adhérer ou non. Il est même possible de discuter, de poser des questions, de préciser tel ou tel conseil pour mieux l’assimiler. Ce dialogue ouvert contribue à nourrir une réflexion profonde et nous évite de tomber dans un suivisme aveugle.
Dans cette dynamique, l’équilibre à trouver est le suivant :
Reconnaître que des individus ont pu acquérir une réelle expertise ou une intuition solide dans un domaine précis. Admettre que, malgré cela, nous sommes seuls juges de ce qui s’intègre ou non dans nos objectifs et nos valeurs. Parfois, nous craignons d’être perçus comme fermés d’esprit si nous n’appliquons pas un conseil. Pourtant, dire « non, je ne pense pas que ce soit adapté à ma situation » n’est pas un signe de fermeture. C’est plutôt la preuve que nous avons fait l’effort de considérer cette option, puis de la confronter à notre réalité. Le respect envers l’autre se manifeste surtout dans la bienveillance avec laquelle nous recevons ses avis et la gratitude de pouvoir en disposer, même si nous n’y adhérons pas.
Lorsque ce respect est mutuel, la relation reste saine. Notre interlocuteur comprend que ses idées sont entendues, qu’elles ne sont pas rejetées sans fondement, mais qu’il existe des paramètres personnels qui entrent en jeu. De notre côté, nous évitons de nous positionner en rebelles systématiques, prétendant que nous n’avons besoin de personne et que le monde extérieur est dépourvu de pertinence.
De même, il est nécessaire de faire preuve de clarté dans la manière dont nous exprimons nos opinions. Dire « je préfère faire autrement » ou « j’ai une expérience différente » peut tout à fait se faire sans brusquer ni dévaloriser l’interlocuteur. La clé réside dans la manière dont nous communiquons notre point de vue : expliquer en quoi cette suggestion ne nous convient pas, plutôt que de la rejeter sans égard.
Enfin, savoir être son propre conseiller signifie aussi s’accorder le droit de changer d’avis quand nos expérimentations nous y invitent. Peut-être avons-nous cru initialement qu’une approche n’était pas intéressante, avant de nous apercevoir, après réflexion et discussions, qu’il valait mieux la tester. Il ne faut donc pas voir cette dynamique comme un jugement définitif, mais plutôt comme un mouvement fluide et évolutif.
Cette souplesse, qui consiste à respecter à la fois son entourage et soi-même, n’est pas un acquis immédiat. Elle se forge patiemment à mesure que nous prenons conscience de nos besoins, de nos aspirations et que nous constatons la diversité des chemins possibles.
Conclusion : Vers une autonomie guidée par l’expérience
Être son propre conseiller, c’est avant tout reconnaître que nous sommes les premiers acteurs de notre parcours de vie. Les opinions extérieures, qu’elles proviennent d’experts ou de nos proches, peuvent être de formidables pistes de réflexion. Mais elles doivent être confrontées à nos expériences, à notre sens critique et à nos aspirations profondes.
En reprenant à notre compte l’idée que nous détenons, en nous, la capacité de vérifier la validité d’un conseil, nous nous donnons le pouvoir d’évoluer et de grandir de manière responsable. Plutôt que de suivre les tendances ou les doctrines, nous apprenons à les interroger, à les tester. Cette approche favorise la construction de valeurs solidement ancrées, car elles se nourrissent directement de notre vécu.
Cela ne signifie pas que nous nous croyons supérieurs aux autres. Au contraire, cela implique de nourrir un profond respect envers leur parole, mais aussi envers la nôtre. Nous pouvons célébrer l’intelligence collective tout en évitant la dilution de notre singularité. Les connaissances du monde sont foisonnantes, et notre rôle est de les accueillir avec discernement, afin d’en retenir ce qui servira réellement notre cheminement.
À chaque fois que nous parvenons à appliquer un conseil de manière éclairée, nous renforçons notre sentiment d’autonomie. Nous devenons davantage aptes à gérer les imprévus, parce que nous savons que nous ne sommes pas complètement tributaires d’une parole extérieure. Au lieu de nous dévaloriser, nous constatons que nos découvertes, nos victoires comme nos échecs, sont le socle d’une véritable confiance en soi.
Bien sûr, ce n’est pas un processus linéaire. Il y aura des moments de doute, des hésitations, des retours en arrière. Mais c’est précisément dans ces remises en question que se trouve le gage de notre évolution. À chaque nouvelle étape, nous incorporons les retours de nos expériences. Nous pouvons revenir sur des conceptions antérieures, nuancer nos certitudes, voire changer radicalement de perspective si les faits nous y invitent.
Se forger sa propre opinion n’est pas l’apanage d’un esprit rigide, ni celui d’un égocentrisme hermétique. C’est un acte d’humilité : admettre que nous ignorons encore beaucoup, et que seul l’effort d’exploration personnelle — alimenté par la sagesse des autres — nous permettra de progresser.
En définitive, notre but n’est pas de prouver que nous détenons la vérité, mais d’être en cohérence avec ce que nous vivons et ce qui nous anime. Devenir son propre conseiller revient donc à honorer la capacité que nous avons chacun de percevoir, d’expérimenter et de conclure pour nous-mêmes. Au fil du temps, cette posture nous apporte un sentiment de solidité : nous savons que nous pouvons compter sur nous, non pas parce que nous refusons l’aide extérieure, mais parce que nous avons appris à conjuguer les connaissances du monde avec notre propre intelligence.
Pour aller plus loin :
- L'art de développer son esprit critique : https://www.revuegestion.ca/lart-de-developper-son-esprit-critique
- Développer sa pensée critique - Paris - Cegos : https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel/developper-sa-pensee-critique
- Éduquer à la Pensée Critique - Apprentivore : https://apprentivore.fr/eduquer-a-la-pensee-critique
- Collection Human Skills : des livres pour booster ses soft skills : https://www.talentlens.com/fr/actualites/collection-human-skills.html
- Les compétences de pensée critique comme objectifs éducatifs : https://www.amazon.com/comp%C3%A9tences-pens%C3%A9e-critique-objectifs-%C3%A9ducatifs/dp/6203776572
- Développer sa pensée critique - Paris - Cegos : https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel/developper-sa-pensee-critique